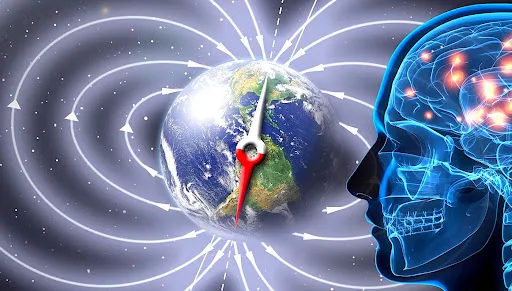Phuoc, se portant garant de moi, a assuré le médecin qui nous a reçus que j’allais coopérer à mon traitement. Celui-ci fit alors avancer un fauteuil roulant ; on m’y installa pour me conduire vers l’aile psychiatrique de l’hôpital Trung tâm điều dưỡng sức khỏe tâm thần de Da Nang (Centre de soins infirmiers en santé mentale de Da Nang).
Permettez-moi, avant d’entrer dans le détail de ce séjour, de préciser deux trois éléments qui doivent être pris en compte autant par le lecteur/la lectrice que moi-même qui regarde ces sept jours avec le recul de près de trois ans.
Le premier : mon niveau de conscience depuis les gestes suicidaires et un peu auparavant. Étais-je lucide, sagace avant de les poser, ce qui déboucha sur mon arrivée dans cet endroit sinistre ? Conscient ? Ma réponse se résumerait ainsi : oui, je savais pertinemment bien, non pas ce que j’allais faire, mais ce que je devais absolument faire afin de me libérer du piège dans lequel une série d’erreurs médicales m’avaient enfoncé. Le 13 avril, autour de 8 heures du matin, je sombrai dans l’inconscience. Si celle-ci induit un agir irréfléchi, j’avoue, qu’ingurgitant des pilules j’étais tout à fait conscient, sachant très bien ce dont j’attendais de ce cocktail. Idem pour la chaise dans les WC de l’hôpital Général de Da Nang. Par la suite, ma dépendance aux autres accapara la place de ma conscience.
Le second : l’immense difficulté à soutenir le rythme stupéfiant du sevrage qui n’alimentait aucun espoir que ma condition - autant physique que mentale - puisse s’améliorer. Mon arrivée à cet hôpital spécialisé coïncida ou précipita une nécessité, celle de créer un personnage imaginaire devant se conformer à un environnement qui dissolvait toutes mes capacités d’adaptation. Un environnement dans lequel évoluaient que des hommes - des très jeunes jusqu’à des assez vieux - dégageant une ténébreuse aura de solitude. Ce n’était pas un environnement, c’était un isolement. Ce personnage qu’il m’est possible maintenant de regarder agir, devait tâcher d’être parmi des êtres qui, manifestement, avaient été soutirés à leur milieu naturel pour je ne sais trop quelles raisons, quels diagnostics.
Le dernier point : ma santé physique. Depuis les bouleversements liés aux brusques modifications de ma médication, ma vue devient de plus en plus floue, j’aurai perdu le sommeil, l’appétit et 25 kilos. J’entre donc ici dans un état de total épuisement, n’ayant aucune souvenance d’avoir dormi et cela depuis plusieurs semaines. Étendu, les yeux fermés, et cela autant de jour que de nuit, je savais pertinemment qu’il m’était possible d’ouvrir les yeux à tout moment.
Aucune souvenance d’avoir pris un repas et cela depuis plusieurs semaines. Tout ce que je sais c’est que maintenant je dois me nourrir... c’est l’assise même de la santé selon les Vietnamiens, c’est la question sine qua non pour y demeurer.
Entrons...
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
Il aura fallu contourner d’étourdissants couloirs avant de parvenir à l’aile où l’on m’assigne. Dépourvu du sens de l’orientation, il m’est impossible de mémoriser le trajet. On s’arrêta devant une porte triplement verrouillée. Phuoc est avec moi. Ne parle pas.
On nous ouvre. Deux employés prennent le relais. Me conduisent à cette chambre disposant de trois lits. Trois grabats. Celui qui sera le mien est collé à une grande fenêtre donnant sur le poste occupé par ce que j’imagine être des infirmiers. On croirait un mirador.
Étourdi, j’évalue le matelas qui semble aussi dur qu’une planche. Sans oreiller, sans drap. Au plafond, un ventilateur tourne à vitesse réduite. Phuoc parle avec un de mes compagnons de salle. Chacun opine de la tête. De plus en plus étourdi, je m’affaisse lourdement. Position fœtale.
Phuoc doit quitter les lieux, les règles anti-covid en vigueur l’y obligent. Il me salue, mais je n’ai aucun souvenir de son départ. Une préposée arrive, me remet une tenue similaire à tous les patients qui se sont agglutinés à la porte de la salle. Bleue. Pour une première fois depuis des lustres, j’habille du “small”. C’est à ce moment précis que j’apprends qu’ici, l’intimité n’existe pas. Ils déshabillent leur nouveau camarade. Un étranger. Le seul sur tout le plancher. Et il est mal en point.

C’est une odeur de remugle qui me ramène à la réalité. J’opte - c’est mon personnage imaginaire qui m’y incite - j’opte donc pour l’indifférence. Mon voisin numéro 1 sera le seul et unique individu à pouvoir converser en anglais avec moi. Il m’annonce être ici parce qu’il a critiqué le Parti communiste du Vietnam dans son patelin, quelque part dans le centre du pays. Il s’attend à être fusillé d’un jour à l’autre. À 50 ans, c’est sa deuxième semaine à l’hôpital, auparavant, en prison où il a intenté à ses jours plusieurs fois. Sa famille l’a renié non pas à cause de ses idées politiques, mais en raison de sa volonté de se donner la mort. Inacceptable pour les bouddhistes.
Mon colocataire numéro 2 entre et sort de la pièce à intervalles réguliers. S’il a 20 ans, c’est récent. Dans notre salle, il est étendu sur son lit, la figure contre le mur. À l’extérieur, aucune idée sur ce qu’il fait. Sept jours et je ne l’aurai jamais entendu dire un seul mot.
Ma thérapie par la nourriture débute sévèrement : un plateau sur lequel il y a une soupe (pho) typique de Da Nang le Bun Bo Hue ainsi qu’un Cao Lau, nouilles de porc laqué et aux herbes. La préposée m’invite à sortir de la salle et m’installe à la porte, sur un banc qui donne sur une cour intérieure très ensoleillée. Autour de ce jardin rectangulaire, des couloirs qu’arpentent d’autres hommes en bleu. Plusieurs s’arrêtent devant moi, examinent les deux plats, salivent puis continuent leur marche dans un régulier froissement de savates. Sans que je puisse réagir, un pensionnaire se précipite vers moi avec l’intention évidente d’attraper l’un ou l’autre des deux plats. Ses yeux percent littéralement la carapace que j’essaie d’afficher. Des patients l’immobilisent avant de le conduire je ne sais trop à quel endroit, sauf que j’entends, au loin, des râles qui tiennent davantage de l’animal que de l’humain. Je ne connais pas encore les règles du jeu, ses lois internes.
Je mange, mais comme j’aurais apprécié que le pillard eut été plus efficace.
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(
L’obscurité enveloppe la totalité de l’aile. Aux dix mètres environ, une ampoule électrique jette par terre un éclairage inadéquat. Mon prisonnier politique me prend par le bras et m’amène à pas de tortue vers un attroupement. Distribution de pilules. La même pour tous. Je ne sais trop de quoi il s’agit, sans doute un somnifère. Si certains guettent la nourriture, d’autres épient les médicaments. Des échanges se trament. Du troc : médicaments contre services sexuels. Les plus jeunes s’y adonnent allègrement. Ils craignent d’être seuls la nuit. Bientôt je vivrai l’objet de leur inquiétude.
Ce scénario sera le même tous les soirs, tout comme se répète celui du jour se résumant... à attendre. Pas de petit déjeuner. Midi, on ouvre une grande salle dans laquelle chacun des patients se présente pour y recevoir sa ration. Fin d’après-midi, on ouvre la même grande salle dans laquelle on leur distribue le dernier repas de la journée. Plusieurs profitent de la générosité de leurs parents qui envoient des victuailles qu’ils ont avantage à cacher pour ne pas qu’on les leur dérobe. Comme ma thérapie se veut centrée sur l’alimentation, je n’ai pas à me rendre à cet endroit, on me sert à l’entrée de la chambre.
Puis c’est la nuit.
L’horrible nuit. Cauchemardesque. Terrifiante. Inhumaine. Je les ai comptées : huit. Encore maintenant, comme un reflux, elles me reviennent à l’esprit dans toute leur répugnance. Leur monstruosité. C’est véritablement ici que se développe l’atmosphère de ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST...
Je suis convaincu qu’une personne ayant vécu cela, une fois sortie de cette aile psychiatrique, n’aura jamais le courage d’en parler, encore moins de le décrier, seulement... l’oublier, si cela est possible. Il m’aura fallu près de trois années avant de regarder cela en face.
À la suite de la distribution du remède devant favoriser le sommeil, le personnel de nuit entre en action : un seul préposé pour plus de cinquante patients. Je le vois par la fenêtre adjacente à mon lit qui donne sur le poste des infirmiers. Autant que je me souvienne, ce sera le même individu toute la semaine. Casque d’écoute aux oreilles, nez plongé dans un livre. Aucune intervention de sa part. Il surveille le bureau et un trousseau de clés déposé sur celui-ci.
Mon colocataire prisonnier politique ferme la porte, ce qui n’empêche pas d’entendre d’abominables cris provenant de derrière les salles les plus éloignées de nous. Ils s’entremêlent à ceux du jeune adolescent, celui qui pleure toute la journée et que d’autres patients frappent pour donner un sens à ses hurlements, et qui habite la chambre à côté de la nôtre.
À ce vacarme infernal, le bruit que font quatre individus entrant dans notre chambre - ils sont armés de bâtons pouvant servir de matraques - est assourdissant. Je ne bouge pas. Un des leurs vide la petite commode dans laquelle nos objets personnels sont rangés. Balance tout le contenu par terre avant de se diriger vers moi. Il s’adresse en vietnamien. Son gourdin sous ma gorge n’a pour but que de m’apeurer. Figé, je ne bouge plus. Ses yeux démoniaques m’observent. Il grimace un sourire arrogant qui me glace littéralement.
L’invasion n’est pas terminée. Le colocataire numéro 2 devient la cible du quatuor. Immobile sur son lit, en deux secondes on le dénude. Chacun, l’un après l’autre, l’aura brutalement sodomisé. Toujours immobile et silencieux, une fois les agresseurs disparus, il se lève pitoyablement, ne regarde rien autour de lui, revêt le pantalon bleu... taché de sang.
Le carnaval durera huit nuits.
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(

À la prochaine