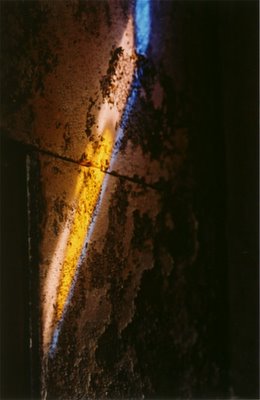Na tujiw nemi’g gitpu gnegg musigisg’tug alaqsing aq gesigawtoqsit. Teluet « Majulgwali ni’n ».
Ce qui signifie lorsque traduit de la langue Mi’kmaw : J’ai vu et entendu un aigle qui volait haut dans les airs dire d’une voix forte « Suis-moi ».
Et notre grand-père suivit Paqsi’ma, l’aîné de la famille Épelgiag. Cela lui ouvrit l’esprit, l’âme et le cœur comme jamais auparavant, comme jamais il n’aurait pu l’imaginer. Encore aujourd’hui, lorsqu’il lui arrive d’en parler, les souvenirs se bousculent avec une telle vigueur, celle que son ami mi’kmaw lui aura insufflée.
La musicalité de sa langue résonne encore à ses oreilles. Toute la sagesse également, celle dont il a su se draper au contact de ces gens. Est-il nécessaire de rappeler qu’ils s’installèrent en bordure de la forêt tout près de l’entrée de l’Anse-au-Griffon? Au début des années 1950. Quelques mois avant le terrible incendie qui détruisit une partie du village, permettant à ses habitants de découvrir l’étendue de leurs préjugés, la force de la solidarité humaine qu’une toute petite flamme, celle d’un fanal allumé à l’entrée d’une église paroissiale, tous les jours ravivait.
Plusieurs semaines avant la catastrophe, alors que les Épelgiag vivaient encore dans leur wikoum (wigwam) de fortune, ayant dû précipitamment quitter Pasbébiac pour des raisons obscures – grand-père ne sut jamais lesquelles et jamais, non plus, il ne tint à les connaître, ayant rapidement compris que l’instant présent est beaucoup important que le passé ou l’avenir- les côtoyer, leur adresser la parole, même signifier leur présence, tout cela était tabou.
Il y avait bien eu, on ne s’en rappelle que trop, l’intervention de l’institutrice Gaudreau qui voulait absolument que les enfants mi’kmaw puissent venir à l’école. On lui fit comprendre que la classe était pour les familles gaspésiennes. À l’époque, on n’utilisait pas l’expression « de souche » mais l’intention était la même. La même exclusion.
L’incendie changea beaucoup les mentalités ambiantes, si je puis dire. Toutefois, des poches de résistance maintenaient certains propos haineux envers les Épelgiag, malgré le fait que le stratagème, le piège comme l’avait surnommé monsieur Koli (ce qui signifie Albert, en français) permit d'éviter pire encore.
Émile, le marchand général, au surlendemain de la catastrophe, tint absolument à « marcher le village » afin de mesurer le plus exactement possible l’étendue de la tâche de reconstruction. On se remémore avec beaucoup de précision cette image devenue une icône dans la région : le marchand général, tête haute, le maire Léo, tête basse, Aldège, la tête pivotant de gauche à droite et celle de monsieur Épelgiag, l’homme au regard d’aigle, qui, au début, fermait la marche, avant de se coller à Émile pour dire dans toute la magnifique sonorité de sa langue :
Lpa mo geituoq ta’n tliatew sapo’nug. Gtmimajuaqanminal pa wijei aq u’n ta’n neia’s’g aq tel’gne’g gesga’s’geg.
Ses mots signifiaient :
Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes comme une bouffée de fumée qui apparaît pour un moment et ensuite disparaît.
Le village, ce palimpseste encore noirci par des colonnes de suie, allait devenir un formidable chantier. Les quatre hommes, côte à côte maintenant, à égale distance les uns des autres, comme autant d’architectes ouvrageant sur un projet commun, se prirent la main, un peu comme la chaîne humaine que le Mi’kmaw avait créée afin de bloquer le vent, et portèrent à leurs pieds, à cette terre essentiellement présente, un regard qui allait les nouer.
- Monsieur Épelgiag, en proposant la chaîne humaine, vous utilisiez le « vous », laissez-moi dire aujourd’hui que c’est maintenant un « nous » que l’on dira.
Les deux hommes se serrèrent la main. Dans leurs yeux, les traces d’une profonde amitié firent leurs premiers pas. Le pacte scellé entre eux, jamais ne fut trahi de part et d’autre. Ceci fut dit en anglais, mais dès ce jour, ils partagèrent pour l’un la langue mi’kmaw (mi’kmawi’simk) et l’autre, le français dans le plus pur respect et une mutualité qui traversèrent le temps… tout ce temps que ces fils de nomades restèrent à l’Anse-au-Griffon.
Ainsi s’acheva le mois de janvier, le mois de la lune des poissons gelés : Punamujuiku’s.
… à suivre… …nmu’ltes…
Ce qui signifie lorsque traduit de la langue Mi’kmaw : J’ai vu et entendu un aigle qui volait haut dans les airs dire d’une voix forte « Suis-moi ».
Et notre grand-père suivit Paqsi’ma, l’aîné de la famille Épelgiag. Cela lui ouvrit l’esprit, l’âme et le cœur comme jamais auparavant, comme jamais il n’aurait pu l’imaginer. Encore aujourd’hui, lorsqu’il lui arrive d’en parler, les souvenirs se bousculent avec une telle vigueur, celle que son ami mi’kmaw lui aura insufflée.
La musicalité de sa langue résonne encore à ses oreilles. Toute la sagesse également, celle dont il a su se draper au contact de ces gens. Est-il nécessaire de rappeler qu’ils s’installèrent en bordure de la forêt tout près de l’entrée de l’Anse-au-Griffon? Au début des années 1950. Quelques mois avant le terrible incendie qui détruisit une partie du village, permettant à ses habitants de découvrir l’étendue de leurs préjugés, la force de la solidarité humaine qu’une toute petite flamme, celle d’un fanal allumé à l’entrée d’une église paroissiale, tous les jours ravivait.
Plusieurs semaines avant la catastrophe, alors que les Épelgiag vivaient encore dans leur wikoum (wigwam) de fortune, ayant dû précipitamment quitter Pasbébiac pour des raisons obscures – grand-père ne sut jamais lesquelles et jamais, non plus, il ne tint à les connaître, ayant rapidement compris que l’instant présent est beaucoup important que le passé ou l’avenir- les côtoyer, leur adresser la parole, même signifier leur présence, tout cela était tabou.
Il y avait bien eu, on ne s’en rappelle que trop, l’intervention de l’institutrice Gaudreau qui voulait absolument que les enfants mi’kmaw puissent venir à l’école. On lui fit comprendre que la classe était pour les familles gaspésiennes. À l’époque, on n’utilisait pas l’expression « de souche » mais l’intention était la même. La même exclusion.
L’incendie changea beaucoup les mentalités ambiantes, si je puis dire. Toutefois, des poches de résistance maintenaient certains propos haineux envers les Épelgiag, malgré le fait que le stratagème, le piège comme l’avait surnommé monsieur Koli (ce qui signifie Albert, en français) permit d'éviter pire encore.
Émile, le marchand général, au surlendemain de la catastrophe, tint absolument à « marcher le village » afin de mesurer le plus exactement possible l’étendue de la tâche de reconstruction. On se remémore avec beaucoup de précision cette image devenue une icône dans la région : le marchand général, tête haute, le maire Léo, tête basse, Aldège, la tête pivotant de gauche à droite et celle de monsieur Épelgiag, l’homme au regard d’aigle, qui, au début, fermait la marche, avant de se coller à Émile pour dire dans toute la magnifique sonorité de sa langue :
Lpa mo geituoq ta’n tliatew sapo’nug. Gtmimajuaqanminal pa wijei aq u’n ta’n neia’s’g aq tel’gne’g gesga’s’geg.
Ses mots signifiaient :
Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes comme une bouffée de fumée qui apparaît pour un moment et ensuite disparaît.
Le village, ce palimpseste encore noirci par des colonnes de suie, allait devenir un formidable chantier. Les quatre hommes, côte à côte maintenant, à égale distance les uns des autres, comme autant d’architectes ouvrageant sur un projet commun, se prirent la main, un peu comme la chaîne humaine que le Mi’kmaw avait créée afin de bloquer le vent, et portèrent à leurs pieds, à cette terre essentiellement présente, un regard qui allait les nouer.
- Monsieur Épelgiag, en proposant la chaîne humaine, vous utilisiez le « vous », laissez-moi dire aujourd’hui que c’est maintenant un « nous » que l’on dira.
Les deux hommes se serrèrent la main. Dans leurs yeux, les traces d’une profonde amitié firent leurs premiers pas. Le pacte scellé entre eux, jamais ne fut trahi de part et d’autre. Ceci fut dit en anglais, mais dès ce jour, ils partagèrent pour l’un la langue mi’kmaw (mi’kmawi’simk) et l’autre, le français dans le plus pur respect et une mutualité qui traversèrent le temps… tout ce temps que ces fils de nomades restèrent à l’Anse-au-Griffon.
Ainsi s’acheva le mois de janvier, le mois de la lune des poissons gelés : Punamujuiku’s.
… à suivre… …nmu’ltes…